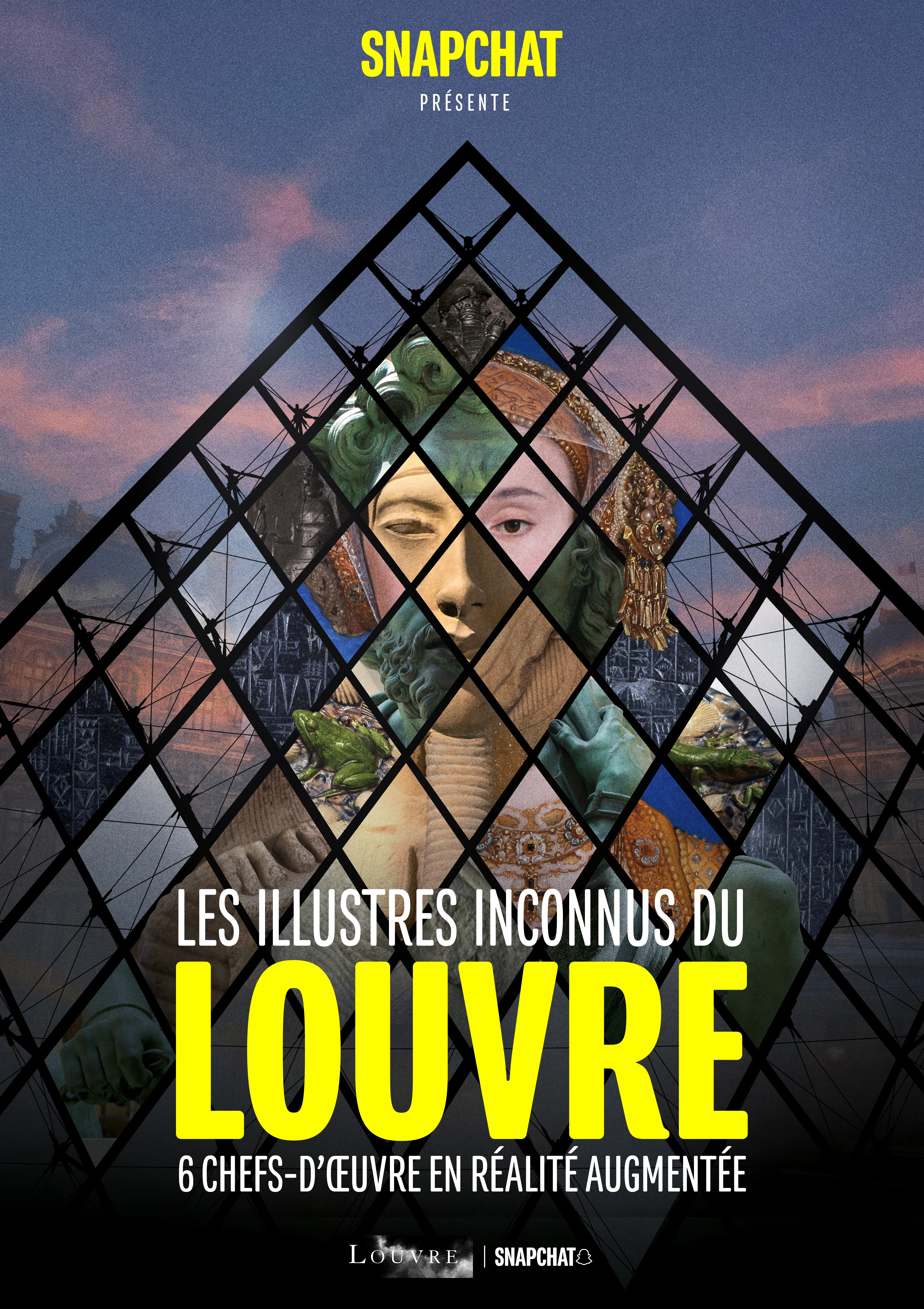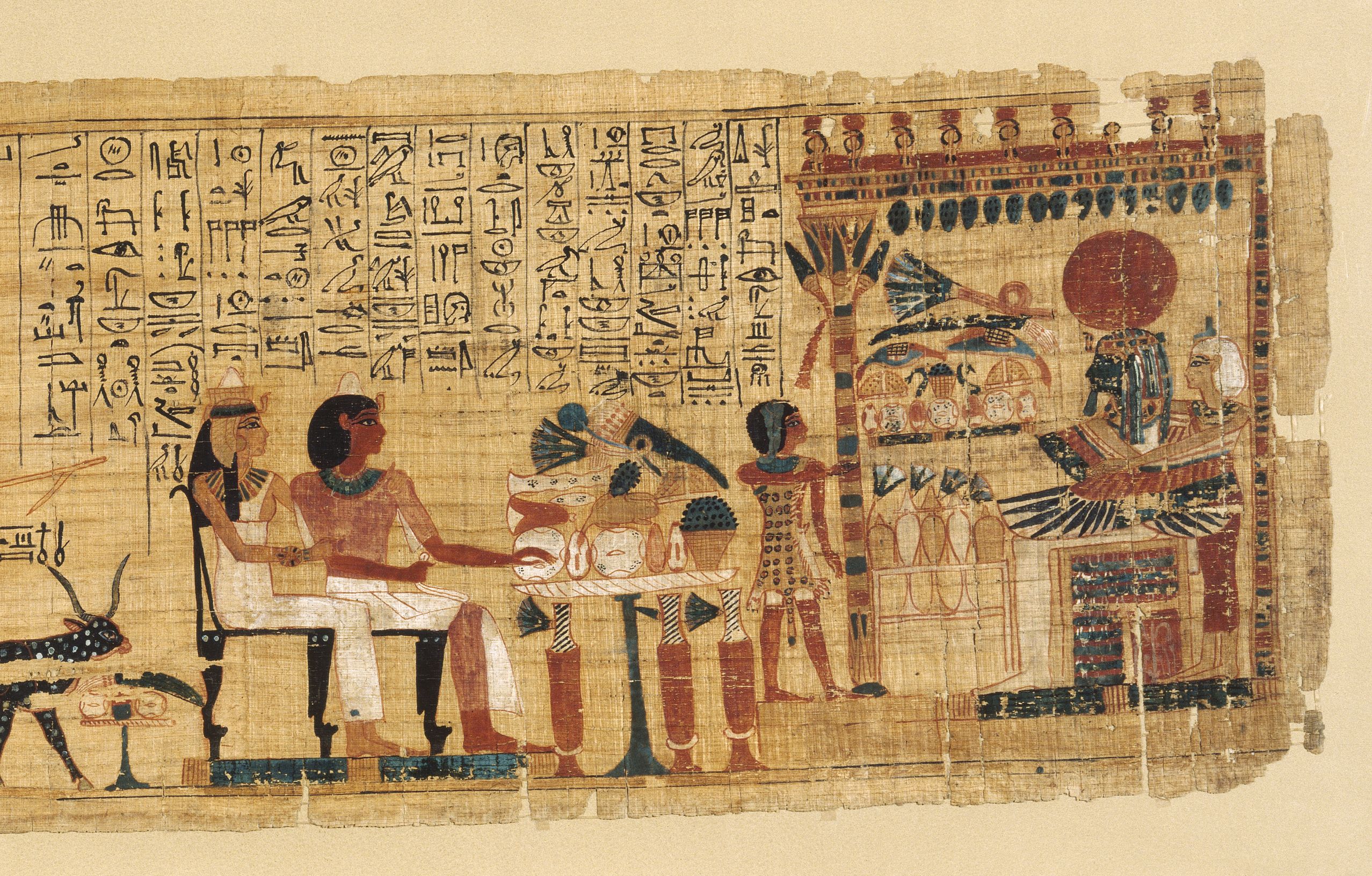Aussi centrale dans les travaux académiques qu’elle peut être brûlante dans l’arène publique, la question du genre s’invite toujours plus dans les institutions muséales. Le sujet devient incontournable dans des espaces où, par essence, le passé dialogue avec le présent, et les regards contemporains percutent d’autres époques, d’autres regards. Une collision d’où émerge, notamment, la nécessité de repenser les récits qui accompagnent les représentations des femmes dans l’histoire de l’art.
Pour une meilleure représentation des artistes femmes
Ainsi, comment présenter des œuvres qui illustrent des scènes de violences envers les femmes ? Le seuil de tolérance de nos sociétés à certaines images de la domination masculine s’est incontestablement réduit, aussi la mise en place de médiation adaptée dans les salles est-elle nécessaire. Les cartels peuvent ainsi intégrer un regard critique sur la représentation de la violence et sur les rôles de genre. Un travail de contextualisation et de réajustement des textes, en fonction d’éléments historiques, doit être mené, dont le prolongement, à travers visites guidées ou conférences, permet d’initier la réflexion et de continuer à faire du musée un lieu où on pense le monde.
Cette quête du mot juste venant aiguiller le regard est essentielle, surtout lorsque l’on parle des artistes femmes, longtemps invisibilisées dans l’histoire de l’art. Comment nomme-t-on – ou pas – les artistes femmes dans les musées ? Celles-ci sont encore trop souvent réduites à leurs prénoms. La rhétorique de l’héroïsation est également un classique du traitement réservé aux femmes artistes : soit elles sont victimisées, soit elles sont des cas exceptionnels. Ce travail de dénomination, qui nécessite une grande rigueur, passe également par des processus de réattribution plus justes, notamment lorsque des œuvres réalisées dans des ateliers comptant pour l’essentiel des femmes sont attribuées aux artistes masculins qui les dirigeaient.
Mieux présenter les artistes femmes était d’ailleurs l’enjeu de l’exposition Elles@centrepompidou, présentée entre 2009 et 2011 au Musée national d’Art moderne. Son objectif consistait à présenter l’histoire de l’art du XXe siècle à travers des œuvres produites uniquement par des femmes. L’exercice, pionnier, ne fut pas sans difficultés, qui nécessita un énorme travail de recherche, en raison du cruel manque d’informations sur les artistes qui devaient être exposées. La plupart des œuvres étaient en réserves, n’avaient jamais été exposées et très peu étudiées. Plus de 2,5 millions de visiteurs se sont rendus à l’exposition Elles : preuve, s’il en était besoin, de la pertinence de cette autre écriture de l’histoire de l’art, donnant à voir des expressions longtemps marginalisées.
Il est difficile toutefois, en dépit de cet élan, de ne pas noter qu’aujourd’hui encore, les stéréotypes de genres persistent. Les artistes contemporaines en font toujours l’expérience, qui continuent à être jugées par rapport au genre auquel elles appartiennent. Artistiquement, professionnellement, on n’attend pas la même chose d’elles que des hommes. Une assignation binaire qui se fissure néanmoins de plus en plus chez les jeunes générations, qui interrogent les stéréotypes, hybrident les identités et tentent de déconstruire les attentes liées au masculin et au féminin.
Le changement doit venir des musées
Cette évolution, intervenue de longue date dans les milieux académiques, les musées se doivent aujourd’hui de l’accompagner. L’objectif est d’en faire des espaces dans lesquels le monde se pense, surtout à travers les images, qui constituent la matière première des musées. Les expositions peuvent alors devenir un laboratoire de réflexion et l’occasion de tester de nouvelles pratiques, de médiation notamment. Il existe diverses manières de mobiliser le genre, comme le démontre la pluralité des expositions qui s’intéressent au rôle des femmes : expositions monogenrées regroupant plusieurs artistes, expositions monographiques féminines, expositions thématiques autours des femmes et leurs rôles dans le monde de l’art.
Combler les silences de l’histoire ne se fait pas, en outre, sans susciter des critiques. La plus récurrente consistant à considérer qu’exposer seulement des femmes peut s’avérer contre-productif, et les ghettoïser davantage. En réponse, les défenseurs de ces expositions arguent qu’un espace d’expression exclusif aux artistes femmes, même temporaire, demeure une meilleure solution que de les condamner à l’invisibilité.
Historiquement, les femmes ont été motrices dans la reconnexion des musées comme lieux de vie. Elles ont été à l’avant-poste en terme de démocratisation culturelle et de médiation. Elles ont lutté avec conviction pour imposer la présence des femmes dans les musées. Aujourd’hui, indifféremment de leur genre, un certain nombre d’acteurs et d’actrices du monde de l’art travaillent à poursuivre cette évolution, avec le soutien du ministère de la Culture, très attentif à la question de la parité. Il dispose ainsi d’un observatoire des inégalités, ce qui demeure une singularité.
Le musée du Louvre a signé en septembre 2024 une convention de partenariat scientifique et culturel avec l'association AWARE (Archives of Women Artists, Research and Exhibitions). Fondée par Camille Morineau, l'association a pour mission la création, l'indexation et la diffusion d'informations sur les artistes femmes et non-binaires. De ce partenariat sont nés des notices biographiques et des articles thématiques sur les artistes femmes et leurs œuvres conservées dans les collections du musée.
L'égalité se construit progressivement. Chaque exposition, chaque cartel repensé, chaque visite guidée adaptée contribue à un musée plus juste, plus ouvert et plus conscient des récits qu'il transmet. Aussi notables soient-elles, ces récentes évolutions sont toutefois tempérées par la froideur des statistiques. Ainsi au MoMA, 80% des nus représentent-ils des figures féminines, mais seules 5% des œuvres sont signées par des femmes. La lumière nouvelle qui s'infiltre dans les musées est encore tamisée.