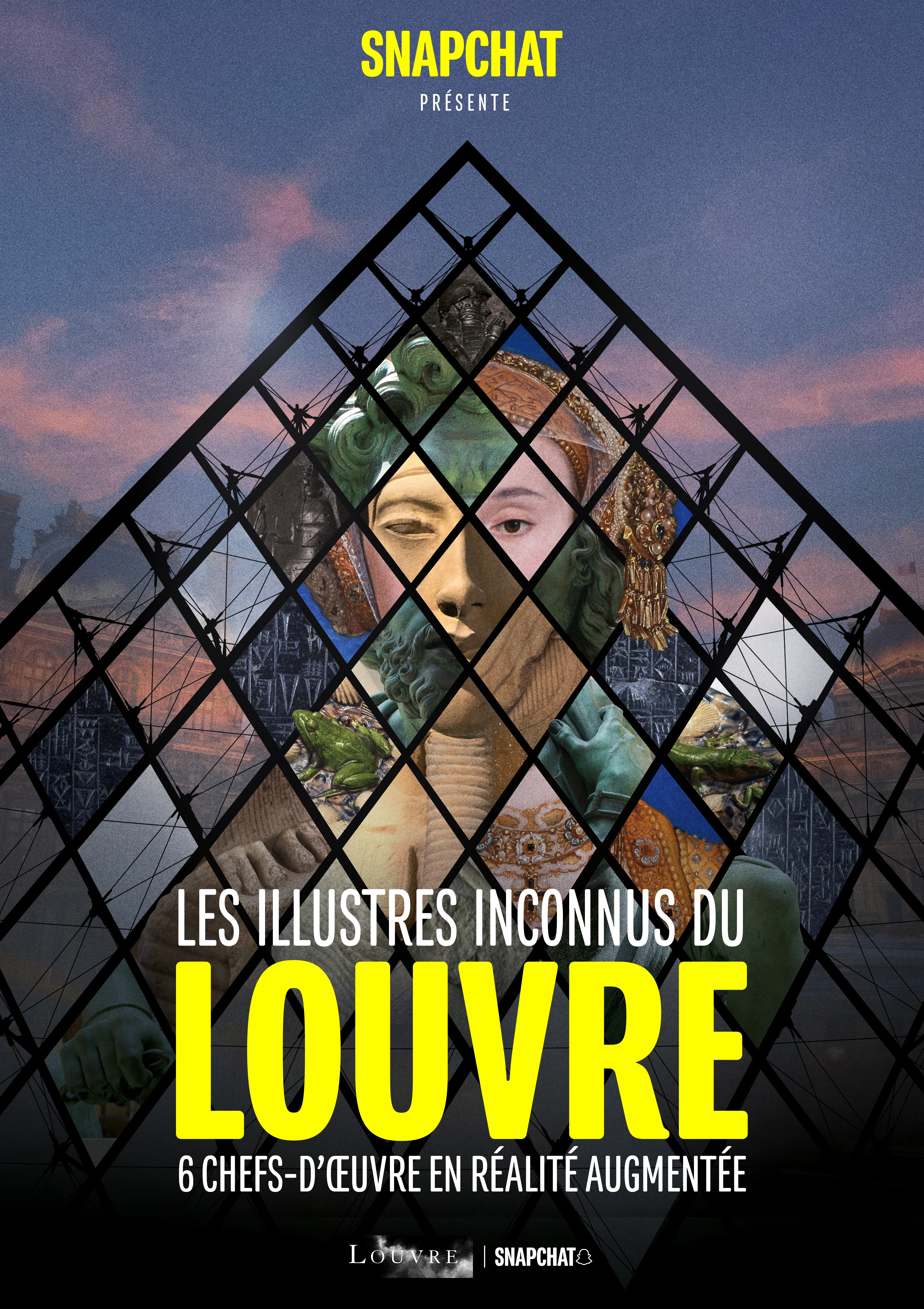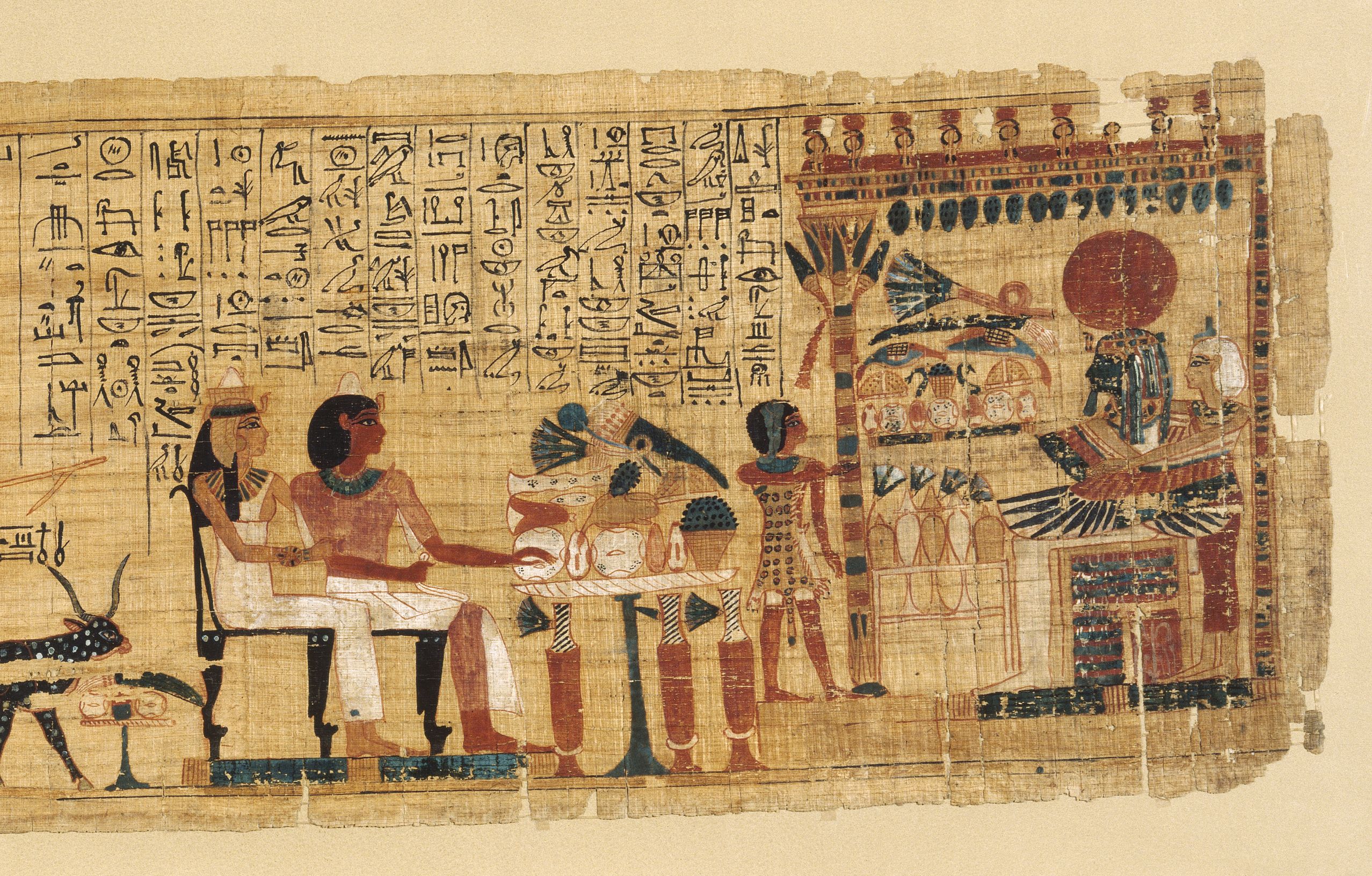Restauration du "Transport du Christ vers le tombeau" de Titien
Vie des collectionsRestauration
Grâce à la restauration réalisée avec le Centre de recherche et de restauration des musées de France, le tableau, dont les vernis étaient très oxydés, a retrouvé les couleurs lumineuses choisies par l’artiste.
Titien peint le Transport du Christ vers 1520, durant son séjour à Mantoue. La composition s’inspire de la Mise au tombeau de Raphaël, aujourd’hui conservée à la Galleria Borghese de Rome. Dans une volonté réaliste, Titien rend tangible le poids du corps supporté avec effort par Nicodème et Joseph d’Arimathie. La tension dramatique s’exprime dans le jeu des regards. La Vierge, en larmes, regarde son fils, tout comme la Madeleine, dont le visage exprime autant la douleur que la colère. Saint Jean pleure également et se tourne vers Marie, que Jésus lui a confiée. En bas, au centre de la composition, la couronne d’épines est posée presque négligemment contre la pierre sur laquelle s’appuie Joseph, comme si on venait de l’y déposer après l’avoir ôtée de la tête du Christ.
Le tableau demeure dans les collections des Gonzague* jusqu’en 1627, date à laquelle il est acheté par Charles Ier d’Angleterre. En 1649, lors de la dispersion des biens du roi après son exécution, il est acquis par Everhard Jabach, banquier et collectionneur originaire de Cologne installé à Paris. Ce dernier le cède à Louis XIV en 1662. A la Révolution il passe des collections royales à celles du musée du Louvre.
Le Transport du Christ n’a pas subi d’altérations majeures. Un accident survenu alors que le tableau est encore à Mantoue est mentionné. Accroché dans une chapelle pour la dévotion des fidèles, la toile est brulée par un cierge au niveau du manteau de Nicodème. Autre modification notable, l’ajout de deux bandes en partie haute et basse. Les dimensions de l’œuvre consignées dans l’inventaire des tableaux de Louis XIV dressé par Le Brun en 1683 indiquent que cet agrandissement, désormais caché par le cadre, eut lieu avant cette date. Plusieurs restaurations sont par ailleurs documentées, en 1786, 1794, 1848 et 1935. La dernière intervention sur l’œuvre remonte à 1940, un allègement superficiel des vernis.
En 2024, l’importante oxydation des vernis, qui gênait la lecture de l’œuvre, a motivé la décision d’une nouvelle restauration.
L’étude préliminaire, conduite par Elisabeth Ravaud au laboratoire du Centre de recherche et de restauration des musées de France, a confirmé le bon état de conservation de l’œuvre. Elle a par ailleurs éclairé le processus de création. Ainsi la radiographie a révélé une composition initiale inversée par rapport à celle finalement réalisée. D’autre part, la réflectographie infrarouge a permis de discerner le dessin sous-jacent tracé au pinceau.
La restauration a été confiée à Dominique Dollé. L’intervention a débuté par une phase de tests visant à déterminer la méthode à employer pour l’allègement des vernis et l’élimination des repeints anciens. Après nettoyage la couche picturale est apparue en bon état, hormis quelques usures et l’altération du jaune d’orpiment du costume de la Madeleine. Les retouches picturales se sont ainsi limitées à atténuer les usures pour rééquilibrer la palette.
Le résultat est impressionnant. Les coloris originaux, clairs et lumineux sont révélés tels le blanc éclatant du linceul ou le bleu lapis intense du ciel et du manteau de la Vierge. La gamme colorée riche et contrastée restitue la profondeur et le dynamisme de la composition. L’intensité dramatique de la scène est soulignée par le traitement très original de la lumière. Ainsi l’ombre dans laquelle sont plongés le visage et le buste du Christ annoncent l’obscurité du tombeau quand l’éclairage qui fait resplendir le linceul traduit l’espoir de la résurrection. On perçoit également mieux la manière virtuose et variée de Titien, qui traite de façon différente les visages ou les drapés, allant jusqu’à une touche « impressionniste » sur le revers du manteau de Nicodème. La restauration restitue ainsi l’œuvre dans toute sa complexité.
*La dynastie des Gonzague règne sur Mantoue de 1328 à 1708.